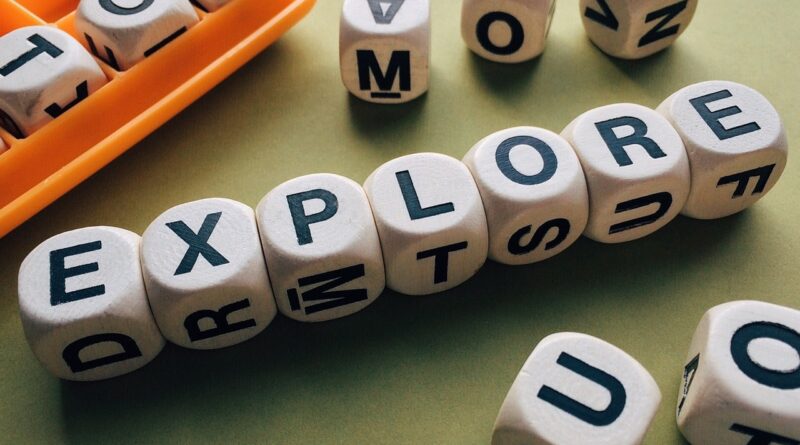Ressuscitons certains mots
Dans ce qui va suivre, je propose de revisiter des mots et/ ou concepts et les réalités qu’ils représentent puisque nous les avons quasiment radiés de notre vocabulaire, suite à la connotation négative qu’ils ont fini par avoir au fil du temps. Il s’agit de trois mots, à savoir : l’obéissance, le sacrifice et le mystère.
Obéissance.
De nos jours, on n’aime plus entendre parler de l’obéissance puisqu’elle traîne derrière elle l’idée de soumission, d’assujettissement, de fidélité, d’autorité, de subordination…, bref des réalités que la société occidentale réprouve. Cependant, avant de rejeter ce mot, il convient de se poser quelques questions. À quoi, à qui et pourquoi doit-on obéir ? De manière générale, on ne peut obéir qu’à ce qui apporte le bien à tous et à soi-même, comme, à titre indicatif, la loi. Pour la paix sociale, l’harmonie entre nous, les lois s’imposent et obligent. Sans elles, on vivrait dans une société anarchique. Cela n’est avantageux pour personne. À ce titre, on doit obéissance à la personne qui représente la loi et qui, par ce fait même, détient une parcelle d’autorité. En revanche, on n’est pas obligé d’obéir à une loi injuste, ni à une personne qui n’intègre pas la loi et nous contraint à accomplir des actes contraires au bien commun, à la morale, à l’éthique et au bien divin. D’ailleurs, comme l’avait si bien dit saint Augustin, on ne peut tenir pour une loi, celle qui n’est pas juste.
Pourquoi doit-on obéir ? Parce que l’obéissance ne porte que sur le bien. Or, aucune personne sensée ne préfère le mal au bien surtout si elle doit en être victime. Aussi, devant le bien, on se plie. Les chrétiens doivent une obéissance totale à Dieu parce que pour eux, étant AMOUR par excellence, Dieu est non seulement le créateur mais Il est aussi le sauveur. Il ne veut que le bonheur de tous et de chacun. Dans cette perspective, on peut dire qu’obéissance signifie dire OUI, céder au bien, à tout ce qui le favorise. L’obéissance implique une résistance au mal et à tout ce qui l’incarne. On ne peut obéir qu’aux valeurs, comme l’amour, la justice, la paix…. et aux personnes qui les assument dans leur vie et qui les répandent. Dans cette perspective, l’obéissance est plus positive que négative, à moins de perdre la notion du bien dans nos sociétés.
Le sacrifice
Derrière ce mot se cachent d’autres et leurs réalités comme le renoncement, la privation volontaire, l’abnégation, l’abandon…. Dans le contexte religieux, le sacrifice signifie l’offrande rituelle à la divinité, caractérisée par la destruction réelle ou symbolique. Dans l’Ancien Testament, on sacrifiait pour le culte, les animaux et pas les humains. Dieu avait refusé le sacrifice humain qu’Abraham voulait lui offrir. Mais si le terme et la réalité sacrifice sont aujourd’hui devenus quasiment obsolètes dans nos sociétés d’aujourd’hui, c’est plus à cause de ses synonymes comme le renoncement, la privation, l’abnégation qu’à son sens profond. Cela s’entend bien puisque nous vivons dans une société qui met un certain nombre de biens matériels à notre disposition, facilitant même les moyens de les acquérir et nous poussant à les consommer, à les posséder, à en profiter, à en jouir davantage. Alors, on ne trouve pas les raisons de s’en priver ? Mieux vaut saisir les opportunités qui se présentent à nous.
Mais comme pour l’obéissance, il convient de se poser quelques questions avant de radier sa réalité et ce mot dans nos vies : que doit-on sacrifier, pour qui et pourquoi. On ne sacrifie que ce dont on dispose ou ce qu’on est. Cela peut aller des biens matériels à son temps et à sa vie. On consent à de tels sacrifices pour de nobles causes, comme le bien, l’épanouissement d’autrui, de la collectivité, de la nation. Bref, le sacrifice ne s’effectue que pour le bien et le bonheur de tous. Quand Télé vie lance un appel pour faire avancer les recherches sur le cancer, on se prive de ses 100 € ou plus pour cette cause. On aurait pu s’en servir pour soi-même mais on consent à les donner à l’humanité pour une noble cause. On ne se sacrifie pas pour rien mais toujours pour quelque chose de bien. Je me prive pour que les autres puissent disposer de cela. Les personnes qui sont mortes pour avoir cherché et lutté pour la justice et la paix, ne sont pas mortes pour rien. Elles ont donné leur vie à l’humanité pour une noble cause. Elles ont ainsi accompli la parole de Jésus : Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime. Jean 15,13.
Aussi, plutôt que de nous inscrire toujours dans le registre de nos propres avantages et intérêts, de la possession et de la consommation, de l’individualisme et donc de celui de chacun pour soi, ne pouvons-nous pas renverser la vapeur pour nous situer dans le paradigme des intérêts de tous, de la gratuité, c’est-à-dire d’un monde désintéressé qui ne viserait que les avantages de tous en sachant que nous y retrouvons également notre compte ? Le sacrifice se comprend dans ce sens.
Le mystère
Aujourd’hui, ce terme et cette réalité sonnent faux dans nos oreilles parce que nous redoutons ce qui est caché, voué à ne pas être connu, ce qui dépasse nos intelligences. Nous voulons, grâce aux différentes disciplines de connaissance qui existent, tout savoir, tout expliquer et tout justifier. Nous voulons tout maîtriser. Or, ce qui est mystérieux, nous défie. Pour ne pas nous sentir dérangés, nous l’excluons de notre quotidien. D’ailleurs, n’est-il pas déjà sécularisé, désenchanté ? Nous sommes dans le monde, nous entendons y vivre et non nous projeter dans un monde inconnu, invisible qui échappe à notre entendement. Ce terme et sa réalité ne sont plus utilisables que dans le contexte religieux où il ne signifie pas ce qui dépasse définitivement notre entendement et nous échappera toujours. Du point de vue religieux, mystère signifie secret, c’est-à-dire ce qui ne doit pas être dévoilé à n’importe qui mais à quelqu’un de confiance, avec qui on partage son intimité.
Dans la perspective religieuse, on ne parle du mystère qu’à propos de Dieu qui est invisible, même s’Il s’est révélé à l’humanité. Ce qui le concerne demeure mystérieux pour l’homme sauf s’il entre dans l’intimité profonde avec LUI. C’est alors qu’il commence à découvrir Dieu, à Le connaître progressivement. C’est Dieu lui-même qui lui livre ce secret, qui se démasque pour se faire voir. Dans la vie courante, les choses se passent également ainsi. La nature dispose également de secrets que ne peut connaître que la personne qui se connecte continuellement avec elle. Nous pouvons même arguer que les scientifiques ont percé ce mystère en l’étudiant de manière profonde. Il en est de même des amoureux. L’autre demeure un mystère tant qu’on entretient avec lui des relations superficielles. Dès qu’on l’approche, on l’apprivoise, on intensifie les rencontres, on dialogue et on instaure la confiance, le masque va tomber et le mystère se dévoiler. Dans la mesure où mystère prendra pour nous le sens de secret, ce mot réapparaîtra dans notre langage.
Denis Kialuta Longana